

|
BARBENTANE L'Ermitage de Bagalance |
|
Actuellement, les terres situées à la pointe Sud-Est de notre territoire, celles qui font limite avec Graveson, paraissent désolées et délaissées. Et pourtant, c'est dans cet espace délimité par le chemin des Carrières, la voie de chemin de fer (la PLM) et la colline dénommée "Mount dou Pastre" qu'ont été retrouvées les traces les plus anciennes de constructions sur notre territoire. C'est aussi dans cet espace qu'était le village historique de Fretta. Et, à deux pas de là, a été découvert notre premier Barbentanais, un Chasséen (moins 3 000 ans avant JC) dont le temporal droit a été mis à jour par Monsieur Jean Aubert lors de fouilles qu'il a menées en 1957… |
|
L'Ermitage et l'Oppidum n'attendent que votre visite ! |













|
Alors, si tout cela a disparu ou est recouvert par des mètres cubes d'alluvions, il nous reste encore de belles traces de ces lointaines humanisations. Tout d'abord, et même s'il n'est pas vraiment Barbentanais puisque placé sur le territoire administratif de Graveson, l'Oppidum(1) de la Roque ne peut que nous intéresser. Installé sur un éperon rocheux qui domine la plaine environnante de ses 70 mètres de haut (voir article spécial en bas de page)... |
|
La façade Est de l'Ermitage de Bagalance vers les années 1950 |
|
Construit par les Celto-Ligures, c'est probablement un des plus vieux connu, puisqu'il date de moins 700 ans avant JC(2). Comme toujours pour ce genre de construction, il est situé dans un endroit stratégique, à la pointe la plus Nord-Est du massif de la Montagnette(3). En outre, à ces époques, un des bras de la Durance passait à ses pieds et servait de voie de communication(4) naturelle à qui voulait progresser vers le Nord... |
|
Détruit par les romains au environ du 1er siècle avant JC, peut-être par les armées de Marius lors de leurs stationnements dans la Montagnette, il a été entièrement fouillé par des spécialistes dans les années 1960(5). Il n'en reste aujourd'hui que des traces de moins en moins visibles même pour qui sait où il était… Longeant ce bras de Durance, du temps des Romains, passait la "via Agrippa" qui reliait Arles à Avignon et au-delà. De nombreuses campagnes de fouilles ont montré que tout un habitat était installé là... |
|
Toujours vers les années 1950, la façade Est de l'Ermitage de Bagalance |
|
Une nécropole a été utilisée pendant de nombreux siècles, des assises de tours, des habitations, etc… D'autre part, certains y placent notre Bellinto, pourquoi pas. Sachant que sous ce vocable on désignait surtout le lieu de passage qui permettait de traverser la Durance avec une certaine facilité, il est très probable que lui aussi suivait son lit, se déplaçant au gré des humeurs de cette rivière qui a été, et reste encore, très fantasque… |
|
C'est donc à proximité de ces emplacements historiques que s'est construit, avant le IX siècle, la Chapelle, puis l'Ermitage de Saint-André-de-Bagalance(6). Il fait partie des nombreux prieurés qui parsèment la Provence depuis le XIIème siècle(7), souvent construits dans des lieux isolés, mais toujours aux abords de drailles empruntées par les Roumieux (pèlerins) et/ou les bergers... |
|
La chapelle aujourd'hui vue du chemin de Bagalance |
|
Servaient-ils alors de lieux d'abri et/ou de restauration, c'est grandement possible, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, en ces époques où ni les cartes ni les vues aériennes n'existaient, de points de repère sûrs et fiables puisqu'habités… |
|
Motifs d'origine wisigothiques sculptés sous l'ancien porche |
|
Autres motifs sculptés sous l'ancien porche |
|
Son premier vocable était Saint-André(8)-de-Tybeli ou bien Saint-André-de-Tyberi (raccourci de Tibériade ???). Ce nom disparaît au XIIème siècle pour adopter celui de Bagalanse, puis Bagalose, puis Bacalose, puis Cacalose pour finir par Bagalance. Il est à penser que ce toponyme est tiré du latin païen Bacchus(9) ou Bacca qui deviendra un patronyme très répandu dans la région... |
|
Dans les cadastres anciens on trouve, aux environs de l'Ermitage, un rocher de nom de Trulhus où, jusqu'au XVIIIème siècle, se faisaient encore des criées et les publications officielles des règlements communaux. Le chemin qui le dessert s'appelait soit la Via Blanca soit le chemin des Escatillons soit celui des Pillières, rien n'est vraiment sûr quand à sa dénomination. Même maintenant au cadastre de Barbentane il n'a pas de nom. Du côté de Graveson, ils l'ont baptisé en simple logique Chemin de Bagalance. Il reliait Graveson à Boulbon et/ou Aramon(10) en passant par la faible pente de la trouée du chemin des Carrières pour rejoindre l'antique voie romaine située derrière le mas de Béquier. C'était donc un passage d'importance pour les trafics d'Est-Ouest, de la Durance au Rhône et au-delà, en évitant les plaines marécageuses et souvent inondées du confluent… |
|
Tout laisse à penser qu'à l'origine, et en ce lieu, il y avait un antique Sacellum(11), remplacé au moins au IXème siècle, peut-être avant, par une construction couverte. N'oublions pas qu'au VIème siècle de nombreuses invasions, par vagues successives et destructrices, ont rasé définitivement le village de Fretta et les nombreuses constructions qui subsistaient de l'époque Romaine. Elles ont laissé nos campagnes en état de ruines. Plus âme qui vive ne devait séjourner durablement dans ces endroits isolés, seuls les chemins devaient être fréquentés puisque la plupart d'entre eux, du moins les plus utiles, donc les plus utilisés, servent encore de socle à nos routes goudronnées. C'est donc à partir du IXème siècle, dans une campagne légèrement plus sécurisée, que des moines bâtisseurs ont commencé à élever des constructions plus 'protectrices' avec des murs-remparts et se sont mis à assécher les marais qui stagnaient dans les basses plaines. C'est le siècle des reconstructions, d'ailleurs c'est aussi à cette époque que Barbentane s'est entourée de ses premiers remparts, c'est aussi le siècle d'une reprise liturgique et artistique… |
|
Cette époque a laissé à l'Ermitage des traces visibles, on y voit toujours, dans ce qui reste de la chapelle, des sculptures en bandeaux d'inspirations wisigothiques. Toutefois, c'est au XIIème siècle que l'Ermitage prend de belles proportions. On conserve la base saine des murs de la chapelle, on ouvre à l'Est la porte d'entrée et, au Nord, on ajoute une abside en cul de four. Au Sud, est élevé un demi-étage d'habitation, peut-être un dortoir ou une sacristie, toujours visible, et par le même escalier on peut accéder à l'étage de l'Ermitage... |
|
Cette chapelle est orientée Nord-Sud, ce qui est peu courant mais presque obligatoire vu la configuration des lieux. Elle est de style Roman classique. Elle comprend une nef étroite et trois travées voutées en berceau brisé. Elle mesure 18 mètres de long sur une hauteur de 8 mètres. La voute, soutenue par des doubleaux, retombe sur une imposte continue sans fioriture, excepté un fragment ancien d'engrenages et d'oves d'origine antérieure... |
|
L'Ermitage lui-même a été placé à côté de l'entrée de la chapelle qui avait un beau porche aujourd'hui complètement disparu. On peut voir maintenant des sculptures raffinées aux motifs floraux soulignés par des incisions losangées, eux aussi d'origines wisigothiques, datant de la construction originelle de la chapelle. Deux petites fenêtres au Sud et un oculus au Nord, au-dessus de l'abside, laissaient la lumière pénétrer… |
|
Rare décoration sculptée à l'intérieur de la chapelle |
|
L'Ermitage tel qu'il est aujourd'hui |
|
Plus au Sud, creusées directement dans la roche, derrière l'Ermitage, de nombreuses tombes Carolingiennes ont été répertoriées. Elles se caractérisent par une structure triangulaire et, lors du passage à trois voies de la route N570 et dans son extrémité Sud, trois tombes de la même époque et du même style ont été mises à jour. Elles ne sont plus guère visibles, elles se cachent derrière un amas sablonneux, ce qui est pour le mieux… |
|
D'une austérité toute cistercienne dans son apparence extérieure maçonnée, il est certain que son 'intérieur', comme c'était la coutume, était d'une grande richesse de couleurs, avec des décors peints et des fresques de grandes qualités. D'ailleurs vers 1945, en grattant un peu les plâtres protecteurs autour de l'oculus, un amateur avisé et surtout intéressé a découvert une fresque d'une superbe beauté (voir l'article spécial en bas de page)... |
|
Des destructions dues aux troubles des XIV et XVIème siècles ont nécessité des reprises visibles et l'ajout de contreforts aux angles Nord de la chapelle. Quant aux bâtiments de l'Ermitage, ils semblent du XVIème, mais il est probable qu'ils en existaient d'autres auparavant. Ils ont dû être rasés, puis reconstruis, car souvent cette solution est moins coûteuse qu'une restauration… |
|
Escalier permettant d'accéder au demi-étage situé au Sud |
|
En haut de cet escalier, l'étage de l'Ermitage |
|
Devenu trop vaste à entretenir, sans revenus d'importance, il amorce son déclin religieux, mais il n'est pas pour cela abandonné. On y célèbre encore des offices, on y fait des pèlerinages, toutefois son isolement le prédispose aux déprédations. D'ailleurs, en 1694, sitôt la messe annuelle dite, il faut murer la porte d'entrée. Même les autorités religieuses le laissent se dépérir, tout juste y effectuent-elles les quelques travaux qui l'empêchent de tomber en ruine. Au XVIIIème siècle on refait la toiture en tuiles, on met des barreaux et des vitres aux fenêtres mais le cimetière est abandonné en 1755 puisque le dernier véritable ermite du lieu est enterré à Graveson… |
|
En plus, il a une particularité peu banale, si la chapelle est en territoire Barbentanais, l'Ermitage pourtant attenant est, lui, en territoire Gravesonnais… La révolution achève le processus et, le 1er décembre 1791, l'administration du District de Tarascon vend l'Ermitage et les terres avoisinantes pour 4 200 livres à un négociant d'Eyragues. Même lors de la reprise religieuse, en 1830-1836, les derniers ermites attitrés n'y résident plus ; le premier reste à Rognonas et le suivant, qui sera le dernier, réside lui à St Andiol… La construction de la ligne ferroviaire du PLM entre 1843 et 1847 l'isole définitivement. Outre les ravages qu'elle a occasionnés dans les traces historiques en ce lieu(12), son talus fait encore plus rempart qu'un mur. Malgré un passage inférieur pour le chemin de Pelouse qui relie Barbentane à Graveson, l'itinéraire empierré puis goudronné et emprunté de tous, est celui qui longe les voies ferrées. Il canalise ainsi les communications dans un axe Nord-Sud jusqu'à l'Escapade, pour finalement ne donner qu'à cet endroit des possibilités directionnelles vers Est ou l'Ouest... |
|
De plus, les moyens de transport se modifient, finie la marche à pieds, c'est en voitures hippomobiles, puis en automobiles que se font les trajets. Cette nouvelle façon de voyager ne s'économise plus dans des déplacements directs, elle préfère les routes "propres", accessibles en tout temps, même si pour cela on perd un peu de temps… |
|
En 1912, un article de l'Écho de Barbentane fait état de protestations contre un carrier qui extrait des graviers à ses bords, détruisant une fois encore, en ce lieu, toutes les traces qui subsistaient du village de Fretta, des nécropoles et autres habitats très précieux pour la connaissance de ces temps… Malgré cela, l'Ermitage reste toujours un refuge pour des personnes en mal d'habitation et jusqu'aux années 1975, il servait encore d'abri pour un berger et ses moutons. Hélas, un de ses propriétaires, n'ayant vraiment aucun sens du patrimoine, fit désosser et vendit l'abside Carolingienne ce qui a compromis à jamais la solidité de l'ensemble. Le puits a disparu, probablement démonté et lui aussi vendu ; de plus un incendie, malgré son peu d'importance, a fini par l'achever… C'est un beau patrimoine qui souffre maintenant de son abandon. Il est en vente(13), mais les acquéreurs ne se bousculent pas au portillon... |
|
Ce qui était l'abside est devenu un immense trou |
|
Isolé par un chemin maintenant d'accès sélectif, envahi par une végétation abondante tout autant destructrice que les Routiers du moyen-âge, il ne respirera bientôt plus, même son râle risque de ne pas nous troubler tant sa fin de vie est programmée… Guy |
|
Cette fresque du XIIème siècle, d'une grande valeur, était peinte au-dessus de l'abside, placée au-dessus de l'autel et centrée sur l'oculus. Elle a été vendue à un Hollandais, puis a traversé l'Atlantique pour arriver au États-Unis où tout laisse à penser qu'elle y est encore… |
|
La fresque de Bagalance |
|
En haut, s'adaptant à la forme brisée de l'Arc, se trouvent la figure du soleil sous une apparence masculine radiée et celle de la lune sous une apparence féminine au chef surmonté d'un croissant. Allégories très anciennes, teintées de paganisme, d'influence orientale ou catalane, elles semblent sortir d'une mer stylisée comme pour symboliser la naissance toujours renouvelée des jours et des nuits. Une séparation inférieure est donnée par une large bande en chevron rouge soulignée de jaune… Sur la partie centrale, l'artiste a choisi de placer une vision Chrétienne de Jérusalem pour ne pas déparer la symbolique de la Cène du lieu de son action. De part et d'autre de l'oculus, et de façon symétrique, se trouvent des bâtiments paladins à grandes ouvertures, surmontés de deux tourelles encadrant un autre bâtiment plus lointain, ce qui donne un effet de perspective et permet à l'ensemble d'avoir un certain relief... |
|
Ces constructions se terminent par une tour ronde couverte d'un toit surmonté d'une rondeur, semblable à un pompon, avec là aussi une ouverture presque démesurée... Le tout repose sur un large arc surbaissé aux claveaux marqués, retombant sur deux colonnes latérales, l'une à chevrons, l'autre avec des stries obliques, différence qui peut surprendre par rapport à la symétrie presque parfaite de l'ensemble... Dans la mise en scène de la Cène, l'artiste nous montre une représentation simple de la vie quotidienne, avec les ustensiles posés sur la nappe, les plis de celle-ci, le carrelage au sol et l'extrême simplicité des vêtements, juste une toge avec un surplis. Seul St Jean est agenouillé et, avec un autre apôtre, ce sont les deux seuls à ne pas être représentés barbus. Tous sont pieds nus, tous sont auréolés, ce qui peut surprendre car un au moins, si j'ai bien suivi l'histoire, ne l'aurait pas mérité… Cette fresque se termine dans la partie basse par deux écoinçons. Deux aigles sont représentés, l'un les ailes dressées, l'autre les ailes déployées. Là aussi, ce sont des représentations païennes, symbole tant primitif que collectif du père et de toutes les figures de la paternité. Ils font également symétrie avec les allégories païennes de la partie supérieure… |
|
Oppidum de la Roque |
|
Souvent, et par habitude, on attribue aux oppida un rôle religieux. C'est facile et qu'il me soit permis ici d'émettre une autre hypothèse... |
|
Un jour, à la télé, j'ai vu un reportage sur un ancien village de Marrons (esclaves noirs qui s'étaient échappés des conditions inhumaines auxquels ils étaient voués) à l'île de la Réunion. Spontanément, si l'on peut dire, ils avaient clos leur refuge par des cailloux spécialement triés. Ils étaient ni petits, ni gros, adaptés pour être lancés par n'importe qui, femmes et enfants compris. Ce refuge était lui aussi posé sur une hauteur, permettant surtout de dominer les assaillants d'où qu'ils viennent... |
|
Et, cela relève de l'évidence, que ceux qui montaient à l'assaut présentaient le point le plus fragile du corps humain : la tête. Même protégée par un casque, recevoir un caillou lancé de haut, d'un poids adapté, vous sonne pour un bon bout de temps. Or, lors des fouilles que j'ai effectuées durant ma jeunesse sur l'Oppidum de la Roque, j'avais remarqué combien les "cailloux" de l'enceinte étaient réguliers, là aussi ni gros, ni petits. En plus, possibilité du lieu, ils avaient des arêtes vives et tranchantes, ce qui en faisait, outre leurs poids, des armes redoutables et meurtrières pour qui arrivait tête nue ou mal protégée… Guy |
|
Dernières traces de l'Oppidum de la Roque |
|
La reproduction à l'identique de la fresque est peinte à la médiathèque de Barbentane |
|
Sources : Voir bibliographie de Barbentane sur ce même site, et aussi un article signé Joseph Petit, sous le titre "St André de Bagalance, La mémoire des pierres", paru dans le journal Mémori de Casteu-Reinard n°8 de décembre 1991, édité par l'assos Mémori de Casteu-Reinard. Les photos en noir et blanc publiées ici sont extraites de ce même journal. |

|
Tombes Carolingiennes aux abords de la route de Graveson |

|
Barbentane, le plus beau village de l'Univers |

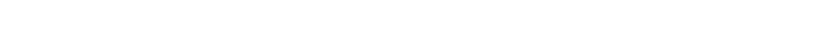
|
1 Un Oppidum, dans le monde méditerranéen, c'est une enceinte close avec des pierres sèches, située sur un monticule naturel (voir en bas de page). De la position de l'Oppidum, par beau temps, si un jour vous avez la curiosité d'y monter, vous verrez un panorama extraordinaire qui va du Nord au Sud en visitant du regard toute la façade Est de notre territoire. 2 En général, leurs constructions datent d'entre le IV siècle et le II siècle avant JC, ce qui donne à celui de La Roque une antériorité toute particulière. 3 En venant de Barbentane, par la route de Terrefort et la draille de Pelouse, garez-vous sous le Mount dou Pastre, juste avant de passer sous les voies de la PLM. Prenez le chemin qui longe les voies et le suivre en montant vers l'ouest. Vous y rencontrerez une flore très spéciale (voir le dossier : Barbentane, les nouveaux envahisseurs sur ce même site, ou cliquez ici). 4 A ces époques et jusqu'au XIX siècle, les voies navigables servaient de voies de communication pour le transport des marchandises, y compris la Durance. 5 Lors de ces fouilles, durant lesquelles j'ai donné quelques coups de pioche, nous avons retrouvé des jarres remplies de semences dans lesquelles étaient incrustés de gros cailloux probablement lancés par les conquérants du lieu. Sans semences viables, et c'était radical, les autochtones étaient bien obligés d'aller s'installer ailleurs. 6 Je ne sais pas pourquoi, mais souvent au village, on dit Bragalance. Or, tant dans les écrits de Sébastien Fontaine que dans ceux du curé Linsolas, ou de Jean Arnaud et de bien d'autres, jamais cette orthographe n'a été notée, mystère… 7 Ceux qui ont réussi le tour de force de rester debout font l'admiration de tous. De St Sixte aux abords d'Eygalières à St Laurent aux abords de Jonquières St Vincent en passant par celui de St Julien à Boulbon, ou le splendide St Gabriel à Tarascon, sans parler des centaines d'autres qui se laissent maintenant contempler tant ces prieurés font corps avec les paysages dans lesquels ils sont installés. 8 L'apôtre André est le deuxième apôtre cité par Matthieu et Marc. On lui donne le titre de «Protoklite» ou «Premier appelé» (par le Seigneur). Il est né à Bethsaïde (Galilée), sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Simon, ils étaient pêcheurs. 9 C'est le dieu du vin, de l'ivresse, des débordements, notamment sexuels, ainsi que de la nature chez les Romains. Il correspond à Dionysos dans la mythologie grecque. 10 Depuis des temps immémoriaux, le passage du Rhône se faisait le plus souvent à la Roque d'Acier, passage étroit, peu variant du fait des collines tant gardoises que 'bouche-du-rhonnaises' qui le canalisent toujours. 11 Diminutif de sacrum, petite enceinte ronde ou carrée, consacrée à une divinité, et contenant un autel, mais sans toit. 12 A cette époque les fouilles préventives n'étaient pas encore inventées. 13 Je sais que l'Ermitage est en vente, mais je n'ai pas réussi à trouver dans quelle agence il est placé, ni pour quelle somme il est proposé à la vente. |